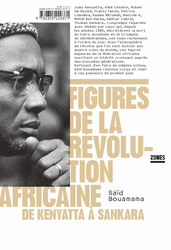Figures de la révolution africaine
Figures de la révolution africaine
Jomo Kenyatta, Aimé Césaire, Ruben Um Nyobè, Frantz Fanon, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Malcolm X, Mehdi Ben Barka, Amílcar Cabral, Thomas Sankara… Longtemps regardés avec dédain par ceux qui, depuis les années 1980, décrétèrent la mort du tiers-mondisme et le triomphe du néolibéralisme, ces noms reviennent à l’ordre du jour. Avec l’atmosphère de révolte que l’on sent monter aux quatre coins du monde, ces figures majeures de la libération africaine suscitent un intérêt croissant auprès des nouvelles générations.
Refusant d’en faire de simples icônes, Saïd Bouamama redonne corps et chair à ces penseurs de premier plan qui furent aussi des hommes d’action. Leurs vies rappellent en effet que la bataille pour la libération, la justice et l’égalité n’est pas qu’une affaire de concepts et de théories : c’est aussi une guerre, où l’on se fourvoie parfois et dans laquelle certains se sacrifient. S’il ne cache pas son admiration pour ces figures rebelles, dont la plupart moururent effectivement au combat, Saïd Bouamama n’en fait pas des martyrs absolus : la pensée en action est toujours située, incertaine, inachevée.
C’est pourquoi ce livre s’attache, avec beaucoup de pédagogie, à inscrire ces parcours dans leurs contextes sociaux, géographiques et historiques. On comprend mieux dès lors comment ces hommes, qui ne vécurent pas tous sur le continent africain, mais furent tous confrontés à l’acharnement des puissances impériales, cherchèrent les armes pour sortir l’Afrique de la nuit coloniale et faire émerger une nouvelle universalité.
À l’heure où l’on se demande comment avoir prise sur le monde, ce portrait politique collectif rappelle qu’il a toujours été possible, hier comme aujourd’hui, de changer le cours des choses.
RUBEN UM NYOBÈ
Ce que nous voulons affirmer une fois de plus, c’est que nous sommes contre les colonialistes et leurs hommes de main, qu’ils soient blancs, noirs ou jaunes, et nous sommes les alliés de tous les partisans du droit des peuples et nations à disposer d’eux-mêmes, sans considération de couleur.
La trajectoire d’Aimé Césaire marque le passage de l’affirmation identitaire à la prise de conscience nationale. Le parcours du Camerounais Ruben Um Nyobè (1913-1958) incarne pour sa part la transformation de cette conscience en action et témoigne de la popularisation du combat nationaliste dans le contexte d’après guerre. La formation politique qu’il reçoit au sein du Cercle d’études marxistes, l’expérience syndicale, la croyance profonde dans la force du droit international et de l’ONU et l’attachement à la non-violence sont autant de dimensions étroitement liées aux nouvelles possibilités ouvertes par la défaite du nazisme.
LA FORCE DU DROIT INTERNATIONAL : « LE CAMEROUN EST UN PAYS LIBRE ! »
Um Nyobè voit le jour en 1913, la même année qu’Aimé Césaire, dans un Cameroun sous protectorat allemand. Les rois douala ont en effet signe en 1884 avec les Allemands un traité dans lequel ils abandonnent « totalement aujourd’hui [leur] droits concernant la souveraineté, la législation et l’administration de [leur] territoirenote ». Les frontières du protectorat ainsi fonde sont l’objet de négociations à la conférence de Berlin (1885). Une série d’accords avec la France et la Grande-Bretagne s’ensuit qui stabilise des 1901 les frontières du territoire. Mais la défaite allemande pendant la Première Guerre mondiale met le Cameroun dans une situation juridique nouvelle. Ce que Ruben Um Nyobè résumera ainsi lorsque, quelques décennies plus tard, il défendra à la tribune de l’ONU la cause de l’indépendance du Cameroun :
Au moment où se termine la guerre de 1914-1918, le Cameroun ne se trouve lie ni par un acte de colonisation antérieur ni par un acte de « protectorat », l’accord conclu avec les Allemands ayant expiré en 1913. Ainsi donc, juridiquement, le Cameroun est un pays libre à la fin de la Première Guerre mondiale.
La position de la France et de la Grande-Bretagne est bien différente, au sortir de la Grande Guerre. Victorieuses des Allemands, les deux puissances coloniales souhaitent en effet annexer la partie du Cameroun que le conflit les a amenées à occuper. Mais cette ambition se heurte à la politique des États-Unis. Le président Woodrow Wilson prononce le 8 janvier 1918, devant le congrès américain, une déclaration en quatorze points détaillant les buts de guerre des États-Unis. Le point 5 préconise :
Un arrangement librement débattu, dans un esprit large et absolument impartial, de toutes les revendications coloniales, base sur la stricte observation du principe que, dans le règlement de ces questions de souveraineté, les intérêts des populations en jeu pèseront d’un même poids que les revendications équitables du gouvernement dont le titre sera à définir.
En cohérence avec sa déclaration et en opposition avec les ambitions annexionnistes des Britanniques et des Français, Wilson défend le principe d’une internationalisation, sous la forme d’un mandat de la Société des Nations, des anciennes colonies allemandes. L’administration des territoires sous mandat est finalement confiée aux puissances coloniales faisant de ce fait de l’internationalisation « un camouflage de la colonisation pure et simple ».
Malgré cette annexion de fait, le Cameroun n’a juridiquement jamais été une colonie. Une telle caractéristique n’est pas sans conséquence sur le processus de décolonisation du Cameroun : les nationalistes – et Ruben Um Nyobè en particulier – feront du droit international l’arme principale de leur combat pour l’émancipation. De même, le partage du Cameroun entre Britanniques et Français les conduit à proposer en 1955 de reprendre l’orthographe allemande du Territoire « Kamerun » de façon, comme l’explique Um Nyobè, à marquer l’opposition des populations à « la division arbitraire de notre pays, division qui a malencontreusement donné lieu aux appellations “Cameroun” ou “Cameroons” suivant qu’on avait affaire à la domination française ou à la domination anglaise ».
Um Nyobè fréquente les écoles presbytériennes dans la partie occupée par la France d’un Cameroun divise. Il fait partie de cette minorité d’indigènes ayant accès à la scolarisation. Fils de paysans, il sera par la suite promu fonctionnaire, d’abord dans le domaine des finances, ensuite dans l’administration judiciaire.
L’après-Seconde Guerre mondiale se traduit au Cameroun, comme dans les autres colonies françaises, par l’obtention de nouveaux droits : droit de se syndiquer et de fonder des partis politiques, suppression du travail force et du régime de l’indigénat, etc. Mais de la reconnaissance d’un droit à sa mise en pratique effective, il y a généralement, en situation coloniale, une longue période au cours de laquelle les indigènes sont contraints de se battre. Le régime de l’indigénat subsiste ainsi plusieurs années après son abrogation officielle. Ces nouveaux droits accélèrent cependant la prise de conscience chez les jeunes « évolués » camerounais. Une prise de conscience syndicale, puis nationale.
DU SYNDICALISME AU NATIONALISME
Cette prise de conscience est en outre facilitée par une poignée d’anticolonialistes blancs installés aux colonies. Membres du PCF, ceux-ci suivent en effet la consigne de leur parti, en 1943, de mettre en place des « Groupes d’études communistes » (GEC) dans les territoires où ils sont installésnote. En septembre 1945, le secrétariat du PCF fixe trois objectifs à ces groupes : agir auprès des Africains, constituer des syndicats regroupant Africains et Européens, et constituer dans chaque territoire un parti progressiste africain.
Un GEC se met en place à Yaoundé de juin 1944 à septembre 1945 sous le nom de Cercle d’études marxistes. Il est fondé par l’instituteur communiste et syndicaliste Gaston Donnat et l’artiste communiste Maurice Méric. Ruben Um Nyobè « le plus attentif, le plus participant, le mieux prépare à ce genre d’activités, y a acquis une formation qui a contribué à faire de lui le grand dirigeant tel qu’il se révéla des 1948 », rapportera plus tard Gaston Donnat.
La question syndicale est, bien entendu, abordée dans les réunions du Cercle. Avant même la parution du décret autorisant la syndicalisation, la séance du 28 juillet 1944 est consacrée à ce thèmenote. La mise en œuvre pratique est immédiate. Le 18 décembre 1944 est fondée l’Union des syndicats confédérés du Cameroun (USCC) qui s’affilie à la CGTnote. La mobilisation est intense et, comme le relève l’ex-militante Marie-Irène Ngapeth Biyong dans ses mémoires, Ruben Um Nyobè se révèle un propagandiste hors pair :
Calme et plein de dynamisme, ce jeune militant syndicaliste, Ruben Um Nyobè […], s’attelle à l’organisation méthodique des travailleurs. Il les regroupe par secteurs d’activité. Très tôt, il gagne la confiance d’un grand nombre de travailleurs et […] la CGT s’implante profondément dans tous les secteurs et particulièrement dans le secteur dominant de la paysannerie qui représente les 95 % de la population active camerounaise.
En situation coloniale, la question sociale débouche presque naturellement sur la question nationale. En témoigne la manifestation que les syndicats organisent le 8 mai 1945, à Yaoundé, capitale administrative du Territoire. Devant la banderole appelant à « enterrer » dans un même geste « le nazisme, le racisme et le colonialisme », les colons blêmissent : « Les Européens voyant passer les Camerounais avec une telle banderole n’eurent pas la larme à l’œil, mais furent choqués, scandalisés : ils sentaient bien qu’il y avait quelque chose de changé dans leur “chasse gardée”note. » Si les colons sont « choqués », les indigènes, eux, ne supportent plus les discriminations racistes, en particulier en matière salariale. En exigeant l’égalité de traitement, les travailleurs camerounais se confrontent au colonialisme. « Aux revendications salariales, résume l’historien Martin-René Atangana, ne tardèrent pas à se conjuguer celles remettant en cause les relations d’autorité entre l’administration française et les populations camerounaises. La revendication prenait ainsi un tour anticolonialiste. »
Gaston Donnat date de la mi-mai 1945 la discussion au sein du Cercle d’études marxistes (rebaptise Cercle d’études sociales et syndicales) portant sur la création d’« un mouvement national camerounais avec comme objectif : l’indépendancenote ». Deux facteurs accélèrent ensuite le développement d’une conscience nationaliste chez les militants. Le premier est la répression à Douala, en septembre 1945, d’une grève des cheminots qui s’étend rapidement à tous les secteurs d’activité et aux nombreux chômeurs qui peuplent la capitale économique du Cameroun. Les colons, auxquels l’administration distribue des armes, tirent sur une manifestation la faisant dégénérer en émeute. « Les Européens se mirent à tourner dans Douala, explique l’historien Richard Joseph, spécialiste du mouvement national camerounais, et la suite ne peut être décrite que comme un massacre, les huit morts et les vingt blessés du rapport officiel ne reflétant certainement pas la réalité. Les Blancs utilisèrent même un avion, duquel ils mitraillèrent les émeutiersnote. » Les dizaines d’assassinats de septembre 1945 cimentent le nationalisme de nombreux jeunes Camerounais. L’expulsion vers la métropole des militants français de l’USCC, dans les semaines qui suivent les événements de septembre 1945, accélère le transfert des postes de responsabilité syndicaux aux jeunes militants camerounais. Um Nyobè devient secrétaire général de l’USCC en 1947. L’expérience syndicale a préparé ces jeunes militants au combat pour l’indépendance.
Le second facteur qui favorise la cristallisation du sentiment national au Cameroun après guerre est la création du Rassemblement démocratique africain (RDA). Ruben Um Nyobè participe, en tant que secrétaire général de l’USCC, au premier congrès du nouveau parti panafricain qui se tient à Bamako en octobre 1946. Tandis que l’Ivoirien Félix Houphouët-Boigny occupe le poste de président, Um Nyobè devient un des vice-présidents du mouvement. De retour au Cameroun, il se met au travail pour fonder un mouvement national en lien avec la dynamique du RDA. C’est dans ce cadre que sera fondée, en avril 1948, l’Union des populations du Cameroun (UPC), dont Um Nyobè devient le secrétaire général – et la figure emblématique – quelques semaines plus tard.
NE PAS AGIR « PAR LE SOMMET »
Son parcours au sein du Cercle d’études sociales a convaincu Um Nyobè de l’importance de la formation aussi bien des « cadres » politiques que des « masses » populaires. Quant à son expérience syndicale, elle lui a fait comprendre qu’il existe une articulation intime entre le combat politique, collectif et général, et la défense des intérêts matériels immédiats.
L’attention aux conditions matérielles de vie des classes populaires urbaines et rurales est une constante de la pensée politique d’Um Nyobè. S’il est un des premiers leaders politiques, en Afrique subsaharienne francophone, à avancer aussi nettement le mot d’ordre d’indépendance, jamais il ne sépare la perspective indépendantiste du combat pour les revendications immédiates.
C’est en partant des préoccupations immédiates des populations qu’Um Nyobè fait progresser chez elles la conscience nationale, c’est-à-dire la conscience d’appartenir à une communauté de situation et de destin. Comme le souligne l’historien Louis Ngongo, le syndicaliste est toujours présent dans l’homme politique :
L’expérience syndicale de Ruben Um Nyobè lui donne […] un avantage indéniable sur d’autres leaders politiques. Au lieu de s’envoler dans des théories fumeuses de liberté, d’indépendance…, le secrétaire général de l’UPC fait passer ses idées en assumant les préoccupations des manœuvres des villes et des paysans des brousses : le prix du cacao, compare au prix du sel et des menus articles importés d’Europe, l’accroissement du chômage, l’insuffisance des hôpitaux et des écoles.
Pour mener à bien ces luttes, Um Nyobè appelle inlassablement les ouvriers et les paysans à s’organiser. L’USCC est, bien sûr, une de ces organisations que l’UPC appelle à renforcer. Décrivant les luttes de ce syndicat dans les différents secteurs où il est implanté (travailleurs du bâtiment, dockers, fonctionnaires, employés du secteur prive, manœuvres, travailleurs des écoles et hôpitaux des Missions protestantes), Martin René Atangana souligne la diversité de ses combats :
Le syndicat exerçait une pression constante dans de nombreux domaines, depuis les questions fondamentales des salaires jusqu’aux demandes telles que la fin de l’immigration des Européens sans qualification, et la campagne contre le tutoiement insultant des fonctionnaires et autres employés camerounais par les Blancsnote.
Le même effort d’organisation est déployé pour structurer un mouvement de femmes camerounaises. Le 3 août 1952 est ainsi constituée l’Union démocratique des femmes camerounaises (UDEFEC). Tout en luttant pour « la défense de la famille camerounaise dans le domaine matériel, moral, intellectuel et culturel [et] la défense du droit des femmes sur le plan économique, social et civique », souligne Marie-Irène Ngapeth Biyong, qui deviendra secrétaire générale de cette organisation en 1954, l’UDEFEC explique inlassablement « qu’aucune amélioration ne peut apporter le bien-être dans les familles camerounaises aussi longtemps que le pays restera sous domination étrangèrenote ». Avec la Jeunesse démocratique du Cameroun (JDC), constituée deux ans plus tard, l’UPC s’intéresse également aux jeunes générations.
L’information sur les luttes de ces différentes organisations est diffusée dans tout le pays par trois organes de presse : le mensuel La Voix du Cameroun, le bimensuel Lumière et l’hebdomadaire L’Étoile. Un autre journal est publié à l’intention de la jeunesse (La Vérité) ainsi que des brochures reproduisant les discours d’Um Nyobè et les travaux des congrès du parti. L’organisation de tous les secteurs de la population à partir de leurs revendications immédiates, et l’effort mène – en dépit des faibles moyens financiers dont dispose l’UPC – pour diffuser les idées de justice sociale et d’émancipation contribuent puissamment à renforcer chez les Camerounais la conscience d’appartenir à une seule nation, et une nation en lutte pour son indépendance.
Si, pour Ruben Um Nyobè, l’organisation est nécessaire, elle n’est pas pour autant suffisante. Mesurant l’état de sous-éducation et d’analphabétisme de la quasi-totalité de la population et conscient du rôle primordial joue par le Cercle d’études marxistes dans sa propre formation, il sait combien les forces adverses sont puissantes : l’école coloniale, qui forme les petits Camerounais à devenir de dociles exécutants, ou l’Église qui, complice de l’ordre colonial, prêche partout l’obéissance aux puissants. À l’effort d’organisation, il convient donc d’ajouter une attention permanente à l’éducation politique.
Il s’agit d’abord de lutter contre la désinformation massive visant à déformer les analyses et prises de position de l’UPC. Il s’agit ensuite d’expliquer simplement et pédagogiquement les différents axes du programme du mouvement national. Enfin, le contact direct avec les ouvriers et les paysans est considéré comme incontournable pour mener à bien ces tâches. Inlassablement, Ruben Um Nyobè parcourt le Territoire pour des tournées de conférences. Il s’y révèle un tribun capable de simplifier sans galvauder, de trouver des exemples accessibles aux plus modestes tout en expliquant ce qui les relie au contexte politique général, national ou international.
L’éducation politique suppose pour Um Nyobè un parti éduqué et organisé. Sur le plan de l’éducation des écoles du parti sont organisées et Um Nyobè ne cesse d’appeler à « déployer tous les efforts pour élever le niveau idéologique des militants et responsablesnote ». Sur le plan organisationnel, Um Nyobè insiste en permanence sur le renforcement des « comités de base ». Il s’agit de construire un parti agissant par en bas. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il préfère parler de l’UPC comme d’un « mouvement » plutôt que d’un « parti ». « Notre mouvement étant le mouvement du peuple, précise-t-il en 1955, rien de valable et de constructif ne peut être réalisé si nous agissons par le sommet comme les colonialistesnote. » Si l’UPC s’organise, travaille avec les syndicats, rédige des tracts et des journaux, structure des mouvements de femmes et de jeunes, ce n’est pas pour prendre le pouvoir – comme affecte de le croire l’administration coloniale –, c’est pour partager des idéaux avec les populations et porter la parole de ces dernières. Lesquelles surnomment rapidement le secrétaire général « Mpodol », littéralement le porte-parole.
ÉMANCIPATION SOCIALE ET INDÉPENDANCE NATIONALE
Attentif à ne jamais dissocier les aspirations populaires immédiates et la défense d’intérêts collectifs généraux, l’Union des populations du Cameroun n’a cessé d’insérer la revendication d’indépendance nationale dans le triptyque qu’elle constitue avec la justice sociale et la réunification de l’ex-Kamerun allemand injustement fractionne. Indépendance, réunification et justice sociale resteront les lignes directrices dans la pensée et dans l’action politique d’Um Nyobè jusqu’à son assassinat en 1958.
Rappelant que l’UPC est une des premières organisations à revendiquer l’indépendance en Afrique subsaharienne, le politologue Jean-François Bayart souligne le « rôle central » que joue cette formation politique dans l’Afrique française d’après guerre : « Elle ouvrit la voie à l’émancipation du Cameroun mais, par-delà, également à celle de l’Afrique noire francophonenote. » La précocité de la revendication d’indépendance nationale n’est pas la seule particularité de l’UPC. Le lien avec l’émancipation sociale et l’égalité économique est également plus construit et plus présent dans les écrits et les discours d’Um Nyobè que dans ceux d’autres figures nationalistes d’Afrique francophone.
L’origine sociale et l’expérience syndicale d’Um Nyobè le conduisent à considérer comme indissociables les revendications économiques et les revendications politiques, comme il l’explique en 1952 :
Le patronat est soutenu par l’administration et cette administration ne peut mener une politique d’oppression nationale dans nos pays qu’en se servant des armes économiques et des moyens matériels détenus en grande partie par les entreprises privées. L’UPC considère, et les militants syndicaux sont de cet avis, que l’émancipation économique de nos populations est impossible sans les conquêtes politiques nécessaires au progrès économique, social et culturel des habitantsnote.
Ces propos portent sur les revendications immédiates sur les plans tant économiques que politique. La même logique est affirmée, dès 1950, pour dénoncer les fausses indépendances qui s’annoncent en Afrique et qu’expérimentent à l’époque plusieurs pays d’Asie :
Là où la pseudo-indépendance a été accordée, surtout par l’impérialisme anglais ou hollandais, les peuples des pays intéressés n’ont pas tardé d’entreprendre une lutte active pour arriver à la véritable indépendance nationale et marcher dans la voie de la démocratie.
Si Um Nyobè n’expose pas de programme économique pour l’après-indépendance, il se positionne en revanche contre les liens néocolonialistes qu’il entrevoit sans que le terme soit encore prononcé. Dans une interview donnée au Midi libre en 1956, alors que la répression française se déchaîne contre les militants « kamerunais », il ne rejette pas en bloc l’idée, avancée par son intervieweur, d’une possible « collaboration » entre la France et un Cameroun devenu indépendant. Mais, précise le secrétaire général de l’UPC, cela doit correspondre à un « désir sincère de la France et des Français, et à la condition qu’une telle collaboration n’implique pas de conditions politiques ou d’autres servitudes similaires ».
Um Nyobè est un des premiers leaders nationalistes africains à comprendre les dangers d’une indépendance simplement formelle, c’est-à-dire se limitant à la sphère politique. Cette conscience des dangers de ce qui sera appelé ultérieurement le néocolonialisme, le pousse à être attentif aux stratégies de partition du Cameroun que développent les puissances occupantes. À celles-ci, il convient de répondre en reliant indépendance et réunification.
L’ENJEU DE LA RÉUNIFICATION
Au moment historique où se constitue l’UPC, l’espoir d’un changement rapide né de l’après-guerre est déjà déçu. La Constitution française de 1946 – qui fonde l’Union française – instaure une assemblée de l’Union française qui est purement consultative et institue le système du double collège électoral (ce qui, dans le cas de l’« Assemblée représentative » du Cameroun, signifie « d’un côté un conseiller pour 250 Européens […]. Et de l’autre un conseiller pour 166 000 Camerounaisnote »). De surcroît, les accords de tutelle, signes en décembre 1946 dans le cadre des Nations unies et prolongeant le système du mandat de la SDN, permettent à la France, selon leur article 4, d’administrer le Territoire « comme partie intégrante du territoire français » en s’octroyant les « pleins pouvoirs de législation, d’administration et de juridiction »note. En d’autres termes, souligne Um Nyobè, le système de la « tutelle » onusienne permet à la France de décréter « l’inclusion pure et simple de notre pays dans l’empire colonial françaisnote ». (Les accords de tutelle pour le Cameroun sous administration britannique reprennent les mêmes formulations.)
Les deux puissances administrantes du Cameroun tentent de jouer la politique du fait accompli afin de faire valider par l’ONU la partition définitive de l’ex-Kamerun allemand. Pendant que la France tente d’intégrer dans l’Union française la partie du Territoire qu’elle administre, le Royaume-Uni cherche de son côté à intégrer la sienne dans le Nigeria voisin, l’une des principales colonies britanniques en Afrique. Accepter l’Union française revient ainsi, pour les Camerounais, à renoncer à la réunification. « C’est donc dire, explique Ruben Um Nyobè, que, pour le Cameroun, la question d’être membre ou non de l’Union française ne saurait être posée avant la réunification et avant la constitution d’un gouvernement camerounais, comportant d’autre part la création d’une Assemblée législative camerounaise. »
Or, pour Ruben Um Nyobè, sans la réunification, l’indépendance est artificielle. La réunification est une condition sine qua non d’une indépendance économiquement viable capable d’assurer de véritables droits aux travailleurs : « Et quand nous posons la question de la réunification, nous avons la conscience de soutenir l’ensemble des revendications des masses camerounaises car, nous ne cesserons de le répéter, tant que les conquêtes politiques ne seront pas effectives, aucune amélioration véritable du sort des travailleurs ne pourra intervenir. »
On le voit dans son argumentaire, Ruben Um Nyobè est un fin stratège qui sait articuler ses revendications en mêlant souplesse tactique et fermeté sur les principes. C’est cette articulation virtuose entre souplesse et fermeté qui explique pourquoi l’UPC est longtemps restée très modérée sur la question de l’échéance de la tutelle onusienne sur le pays. Pendant des années, face à une France cramponnée à la thèse de l’« indépendance prématurée », le mouvement se contente en effet de réclamer qu’un délai soit fixe pour que l’indépendance du Cameroun devienne réalité. « Nous sommes modérés dans notre action, précise ainsi Um Nyobè en 1952. Nous ne demandons pas d’indépendance immédiate. Nous demandons l’unification immédiate de notre pays et la fixation d’un délai pour l’indépendancenote. » Ce n’est que lorsque l’administration française lance, au cours des premiers mois de l’année 1955, une offensive contre ses militants pour mieux préparer une « indépendance sous contrôle », que l’UPC revendiquera l’indépendance et la réunification immédiates du pays estimant que « la question du délai se trouve périméenote ». La radicalisation des positions d’Um Nyobè et ses camarades n’a fait que suivre celle de l’oppression coloniale.
La modération tactique de Ruben Um Nyobè fera de lui un rassembleur de toutes les sensibilités nationales. La fermeté sur les principes en fera un homme à abattre pour le système colonial. L’alliance des deux le transforme en référence bien au-delà de son pays.
L’ARME DU DROIT
Ce qui est également frappant dans la stratégie de l’UPC et de son secrétaire général, c’est leur confiance dans l’Organisation des Nations unies et dans la force du droit international. Même après les accords de tutelle de 1946 qui mettent pourtant en évidence les limites de l’organisation internationale en matière d’application du droit des peuples, Um Nyobè n’abandonne pas l’idée que le droit international est une arme de combat. C’est pour cette raison que ses discours s’appuient méthodiquement sur de multiples textes juridiques, règlements administratifs et autres conventions internationales. Il demande ainsi sans relâche l’abrogation du fameux article 4 des accords de tutelle qu’il juge contradictoire avec l’esprit du système de tutelle en général et avec l’article 76 de la Charte de Nations unies en particulier. Ce dernier article stipule en effet que les puissances administrantes devront « favoriser » chez les peuples qu’elles administrent « l’évolution progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance ».
Pour obliger la France (et la Grande-Bretagne) à respecter cet engagement, l’UPC se saisit de tous les instruments juridiques qu’offre le statut international particulier du Cameroun : elle multiplie les pétitions en direction des Nations unies, organise des manifestations chaque fois qu’une mission d’inspection onusienne se rend au Cameroun (tous les trois ans) et prépare minutieusement chacune des interventions de son secrétaire général à New York (au grand dam des autorités françaises, Um Nyobè est entendu à trois reprises par la commission des tutelles de l’ONU entre 1952 et 1954). Ce contact direct que l’UPC cherche à établir avec l’ONU, court-circuitant ainsi l’administration française, constitue une des stratégies les plus audacieuses et les plus novatrices d’Um Nyobè. Lequel estime que les « Kamerunais » pourront de cette façon faire l’économie de la violence à laquelle la plupart des autres peuples colonisés – qui ne disposent pas de l’arme du droit qu’offre, même de façon limitée, le régime de tutelle – sont obligés de recourir. C’est ce qu’il explique très clairement fin 1952 :
La lutte armée a été menée une fois pour toutes par les Camerounais qui ont largement contribué à la défaite du fascisme allemand. Les libertés fondamentales dont nous revendiquons l’application et l’indépendance vers laquelle nous devons marcher résolument ne sont plus des choses à conquérir par la lutte armée. C’est justement pour prévenir une telle éventualité que la Charte de l’Atlantique et la Charte des Nations unies ont préconisé le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
S’il sait faire preuve de souplesse tactique, parce qu’il pense que c’est la meilleure manière d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés, Um Nyobè n’est pas pour autant un naïf. Il sait que la politique est toujours une affaire de rapports de forces, à l’échelle locale comme à l’échelle internationale. De fait, sa confiance dans l’ONU est aussi le fruit d’une réflexion sur l’évolution des équilibres internationaux : misant sur l’entrée progressive des pays décolonisés dans l’organisation internationale, il compte sur le soutien de ces « nations sœurs » pour remporter le bras de fer qui oppose, à New York, les nationalistes camerounais aux colonialistes franco-britanniques. D’où cette vision très optimiste qu’il expose en janvier 1954 :
Mon impression sur les Nations unies est que la constitution d’un bloc arabo-asiatique représente, avec le groupe soviétique et les démocraties populaires, un atout sérieux pour les pays non autonomes, notamment les pays sous tutelle. À ce groupe se joint presque toujours la Yougoslavie dont la position sur les questions coloniales reste bonne. Il y a également quelques pays de l’Amérique latine.
La conférence de Bandung, en 1955, et les premières indépendances africaines ne feront que renforcer cette conception optimiste des Nations unies et du droit international. Mais c’est précisément au moment de la conférence de Bandung, et alors que les nationalistes algériens lancent leur révolution, que les autorités françaises décident de serrer la vis sur les nationalistes camerounais. Le 13 juillet 1955, alors que ces derniers bénéficient d’une popularité immense au Cameroun et d’un soutien croissant sur la scène internationale, le gouvernement français interdit et dissout purement et simplement l’UPC, privant ainsi Um Nyobè de ses armes favorites au moment précis où celles-ci commençaient à faire leurs preuves.
UNITÉ ET CONSTRUCTION NATIONALE
Le problème national « kamerunais » ne se limite pas à la question de la réunification des Cameroun « français » et « britannique ». Comme de nombreux autres pays colonisés, le Cameroun est confronté à sa diversité ethnique, culturelle, religieuse. Le colonisateur en a d’ailleurs fait un instrument de division permanent. Les réflexions d’Um Nyobè sur l’unité et la construction nationales restent encore aujourd’hui d’une actualité brûlante.
En réaction au viol colonial, les colonisés valorisent toutes les mémoires et les résistances antérieures à la colonisation. En réaction également, s’enclenche une accélération du processus de construction nationale. Confrontées à la même spoliation, les ethnies et tribus qui se percevaient comme différentes, voire opposées, tendent à se percevoir comme appartenant à une même entité qui transcende les formes antérieures d’identification. Le colonisateur pour sa part, légitime, entre autres, sa présence par la négation d’une réalité nationale viable. Pour contrer l’UPC, la propagande française tente rapidement de susciter des « oppositions africaines » à l’UPC, c’est-à-dire de trouver des Africains dociles prêts à s’opposer aux nationalistes et à légitimer le système colonial.
Ruben Um Nyobè sera un penseur de la construction nationale et un adversaire du tribalisme. Il y a ainsi dans ses écrits une critique acérée de tous les intégrismes ethniques ou régionalistes. Le secrétaire général de l’UPC inscrit son analyse de la catégorie « tribu » dans une perspective historique :
Le tribalisme est l’un des champs les plus fertiles des oppositions africaines. Nous ne sommes pas des « détribaliseurs », comme d’aucuns le prétendent. Nous reconnaissons la valeur historique des ethnies de notre peuple. C’est la source même d’où jaillira la modernisation de la culture nationale. Mais nous n’avons pas le droit de nous servir de l’existence des ethnies comme moyens de luttes politiques ou de conflits de personnes.
L’avenir, poursuit-il, n’est pas dans le tribalisme mais dans le cadre d’une nation unie qui est le seul à même de réussir la décolonisation et d’assurer un développement réel :
Une telle situation nous impose comme condition première de rompre avec un tribalisme périmé et un régionalisme rétrograde qui, à l’heure actuelle comme dans l’avenir, représentent un réel danger pour la promotion et l’épanouissement de cette nation camerounaise.
La même approche politique et non ethnique de la nation conduira Ruben Um Nyobè à ne jamais inscrire son combat dans une optique racialiste. S’il dénonce les discriminations subies par les Noirs dans le cadre du système colonial, il n’en conçoit aucune « haine » vis-à-vis des peuples des pays colonisateurs. La lutte vise le système colonial et non les Blancs, rappelle-t-il inlassablement. Dans un discours tenu le 17 avril 1955 devant des milliers de personnes, il répond ainsi à la hiérarchie catholique qui, de concert avec l’administration coloniale, accuse l’UPC de « racisme » :
Ce que nous voulons affirmer une fois de plus, c’est que nous sommes contre les colonialistes et leurs hommes de main, qu’ils soient blancs, noirs ou jaunes, et nous sommes les alliés de tous les partisans du droit des peuples et nations à disposer d’eux-mêmes, sans considération de couleur.
Utilisant les acquis de son éducation dans les missions protestantes, il déconstruit pas à pas l’instrumentalisation coloniale de la religion afin de légitimer l’exploitation coloniale. Il retourne ainsi les arguments de l’adversaire en insérant les textes bibliques – et Dieu lui-même ! – dans la tradition d’émancipation dans laquelle se situent les mouvements anticolonialistes :
Nous avons appris que chacun répondra à Dieu pour son propre compte. Nous en faisons notre principe. C’est pour cela que nous considérons la question religieuse comme une question personnelle devant laquelle chaque individu prend personnellement position. Mais si pour la vie d’au-delà des morts chacun répondra pour son propre compte, les Kamerunaises et les Kamerunais doivent comprendre que tous nous répondrons devant l’Histoire sur notre attitude à l’égard des revendications nationales du peuple kamerunais. C’est pourquoi catholiques, protestants, musulmans, fétichistes et non-croyants, nous devons nous unir et agir ensemble pour hâter l’Unification et l’Indépendance du Kamerun.
Au-delà de l’aspect polémique d’un tel raisonnement, on ne peut qu’être frappe, au regard des multiples divisions ethniques ou religieuses suscitées ou instrumentalisées aujourd’hui par le néocolonialisme, par l’étonnante modernité des conceptions d’Um Nyobè.
La même intelligence apparaît dans la réponse qu’il formule à ceux qui taxent l’UPC de « communisme », accusation très puissante en ces temps de guerre froide :
Les peuples coloniaux ne peuvent faire ni la politique d’un parti, ni celle d’un État, ni, à plus forte raison, celle d’un homme. Les peuples coloniaux font leur propre politique, qui est la politique de libération du joug colonial, et dans leur lutte pour cet objectif si noble, les peuples coloniaux observent et jugent. Ils observent les gouvernements, les partis, les personnages, les organes de presse, non sur leurs idéologies et leurs programmes, mais seulement, et seulement, sur leur attitude à l’égard des revendications des populations de nos pays. Voila la position de l’Union des populations du Cameroun au service du peuple camerounais.
LA QUESTION DE LA VIOLENCE
Um Nyobè espère une décolonisation progressive, pragmatique, telle qu’elle est envisagée dans les colonies britanniques. Ce n’est qu’en raison du refus obstine du colonialisme français d’envisager la moindre évolution vers l’indépendance qu’Um Nyobè et ses camarades se résolvent à envisager la violence comme forme de lutte. Le refus initial de la lutte armée, exprime par le secrétaire général de l’UPC, n’est pas un absolu. Il ne s’inscrit pas dans une philosophie prônant la non-violence comme principe. C’est dans son analyse des rapports de forces, internes et internationaux, que s’enracine son choix d’une lutte pacifique.
Um Nyobè reconnaît la légitimité de la lutte armée ailleurs sur la planète. En avril 1950, il exprime son soutien au combat du peuple vietnamien :
Dans les pays coloniaux, la lutte de libération nationale prend les formes les plus diverses. Pour mieux comprendre la nécessite de cette lutte, je me référerai surtout aux pays coloniaux dépendant de l’impérialisme français. Depuis quatre ans, le peuple vietnamien mène une lutte héroïque pour son indépendance nationale, ceci parce que les colonialistes n’ont pas respecté les accords de mars 1946 qui reconnaissaient l’indépendance du Vietnam.
La position de soutien est la même en ce qui concerne la lutte du peuple algérien que l’UPC « approuve hautement, parce qu’il s’agit d’une lutte de justice et de digniténote ». Mais en ce qui concerne le Cameroun, comme on l’a vu, Um Nyobè estime que l’UPC peut, et doit, faire l’économie d’une lutte armée car il sait que le pays n’en a pas les moyens et, surtout, n’y a pas intérêt.
Reste qu’à partir de 1955, lorsque la France, paniquée par la popularité croissante des mots d’ordre nationalistes, décide d’interdire l’UPC et pourchasse ses responsables devenus subitement « hors-la-loi », la question de la violence se pose à nouveau au sein du mouvement. S’ils affirment toujours vouloir « arriver à l’indépendance sans verser une seule goutte de sangnote », les dirigeants nationalistes se retrouvent pièges par la stratégie de violence adoptée par l’administration française. Se battre ou se soumettre ? Confrontés à ce dilemme, une partie des cadres upécistes se rapproche de l’administration française et s’engage dans la voie de la « reforme ». D’autres, à l’instar du président de l’UPC, Félix Moumié, s’envolent rapidement vers l’Égypte de Gamal Abdel Nasser, le Ghana de Kwame Nkrumah et la Guinée d’Ahmed Sékou Touré pour trouver des soutiens à la révolution armée. Um Nyobè pour sa part tente pendant plusieurs mois d’éviter le pire et d’obtenir le retour de l’UPC dans la légalité. Mais, tandis que la France déclenche au Cameroun une guerre sans merci contre les résistants « kamerunais », il doit se rendre à l’évidence et renonce à contrecœur à la voie pacifique. « Les heures de la patience sont comptées », admet-il, en novembre 1956, alors que la France organise des élections (truquées) pour écarter définitivement les « anti-Français » de la scène politique et faire valider par les électeurs camerounais la stratégie française définie par la « loi-cadre Defferre » (voir chapitre 6)note. Un mois plus tard, l’UPC met sur pied ses premières structures armées.
Réfugie à partir de 1955 dans les maquis de sa région natale, la Sanaga-Maritime, où l’armée française installe début 1957 des dispositifs militaires d’exception comparables à ceux que l’on a vu se déployer au Kénya, contre les Mau Mau, et en Algérie, contre le FLN, Um Nyobè vit pendant trois ans, traque par les militaires français et les milices profrançaises, continuant d’entretenir une correspondance soutenue avec ses alliés locaux et étrangers. Il sera finalement assassiné non loin de son village natal, le 13 septembre 1958, par une patrouille française. Quelques jours plus tard, la France annonce qu’elle prépare l’indépendance du Cameroun. Le 1er janvier 1960, une telle « indépendance » est proclamée par Ahmadou Ahidjo. Lequel, à la tête d’une dictature implacable bénéficiant du soutien indéfectible de Paris, dirigera le pays d’une main de fer pendant plus de vingt ans.
Le parcours d’Um Nyobè et sa fin tragique annoncent le défi majeur auxquels sont confrontés les révolutionnaires à l’ère des indépendances africaines : comment éviter que celles-ci se réduisent à de simples fictions écrites par les puissances coloniales pour leur propre profit ?